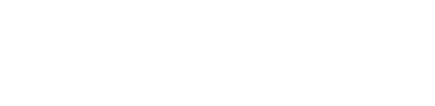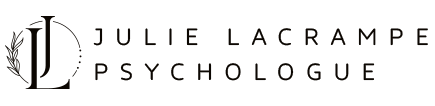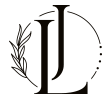La scansion en thérapie : quand le silence parle et que la parole change
Dans les psychothérapies que je mène, il m’arrive souvent de m’arrêter juste là, au détour d’une phrase, à un moment du discours où quelque chose s’ouvre, se soulève, se dérobe… Ces arrêts ne sont jamais anodins. Ils participent pleinement du travail thérapeutique. En psychanalyse, on les nomme scansions. Pour le patient, ces moments peuvent sembler mystérieux, frustrants, voire déstabilisants. Pourtant, ils ont une fonction essentielle dans le processus de transformation psychique.
Cet article a pour but de vous éclairer sur ce que signifie la scansion, comment elle s’inscrit dans le cadre thérapeutique, et en quoi elle peut être une ouverture vers une parole plus authentique, plus libre (en résonance avec mon approche qui conjugue profondeur psychanalytique et accueil inconditionnel de l’humanisme.)
D’où vient la scansion ? Une notion psychanalytique
Le mot scansion vient à l’origine de la poésie : il désigne l’art de marquer le rythme d’un vers, de souligner les temps forts et les temps faibles.
En psychanalyse, notamment dans l’enseignement de Jacques Lacan, la scansion devient un acte du thérapeute : un arrêt volontaire, parfois même une interruption soudaine du discours du patient.
Mais cet arrêt n’est pas un simple silence ou une pause. Il est rythmé, signifiant, porteur de sens. Il marque un point de rupture ou de bascule dans le flux des associations, une ponctuation qui vient souvent révéler — ou révéler l’importance de — ce qui vient d’être dit.
Pourquoi le thérapeute s’arrête-t-il là ?
La scansion peut apparaître comme un geste énigmatique. Pourtant, elle est souvent un temps d’ouverture. En interrompant le fil du discours, le thérapeute vient :
- ● Souligner un moment de vérité, une parole qui échappe au contrôle conscient.
- ● Créer un effet de surprise ou de déplacement, en coupant avant que le discours ne se referme sur une logique trop maîtrisée.
- ● Permettre un ressenti, une émotion, un silence fertile d’émerger.
- ● Interroger l’automatisme, le « discours tout fait » que l’on répète sans plus l’entendre.
C’est une manière de désamorcer les défenses, non pas par confrontation directe, mais en ouvrant un espace où quelque chose d’autre peut advenir (un sens nouveau, un affect oublié, une mémoire refoulée).
La scansion dans une approche intégrative
En tant que psychologue ayant une approche dite intégrative, c’est-à-dire une approche thérapeutique qui combine différentes méthodes, théories et techniques issues de divers courants de la psychologie pour s’adapter aux besoins uniques de chaque personne, je ne me limite pas à une lecture purement psychanalytique. Je m’intéresse aussi à l’expérience vécue, à la relation thérapeutique et à l’instant présent.
Dans cette perspective, la scansion devient également un temps de présence partagée.
Elle peut être :
- › Une invitation au ressenti corporel : « Qu’est-ce que cela vous fait, là, maintenant ? »
- › Une porte vers une parole plus authentique : « Qu’est-ce que vous n’avez pas pu dire ? »
- › Un moment d’accueil silencieux de l’émotion qui surgit.
- › Un geste de respect : celui de ne pas saturer l’espace avec des mots quand un silence peut contenir davantage.
La scansion est ainsi un acte thérapeutique au croisement du langage et de la relation. Elle vient marquer l’importance de ce qui vient d’être dit, tout en offrant au patient l’espace de le réentendre, de s’en saisir autrement.
Comment la scansion est-elle vécue par le patient ?
Chaque patient vit la scansion à sa manière. Pour certains, elle est déconcertante, voire vécue comme un rejet (« Pourquoi m’interrompt-elle ? Ai-je dit quelque chose de mal ? »). Pour d’autres, elle est éclairante : un temps d’arrêt qui permet de mieux entendre sa propre parole.
Il est important de souligner que cette pratique n’est jamais une fin en soi, ni une technique manipulatoire. Elle s’inscrit toujours dans un cadre de confiance, dans une relation de soutien et de co-construction du sens. Ce qui compte, ce n’est pas tant l’arrêt, mais ce qui peut naître après.
Et ce « après » peut prendre du temps. Parfois, un mot dit en séance, interrompu par une scansion, revient des jours plus tard, résonne autrement, ouvre une brèche dans un souvenir, dans une croyance, dans un symptôme.
Scansion et transformation : un rythme pour le changement
La thérapie est un processus vivant, qui ne progresse pas de façon linéaire. La scansion en marque le rythme : des arrêts, des relances, des ruptures, des surprises. C’est une manière d’accompagner la parole vers des zones inconnues, vers des vérités enfouies, vers une subjectivité retrouvée.
Cela signifie respecter à la fois l’inconscient, le vécu, le corps, l’émotion, et la relation thérapeutique. La scansion devient alors un acte vivant, profondément humain, qui donne du poids à la parole du patient, non en la maîtrisant, mais en la laissant résonner.
Entendre autrement, parler autrement
Si vous avez déjà ressenti, en séance, un arrêt soudain, un silence énigmatique, un mot suspendu, peut-être avez-vous fait l’expérience d’une scansion. Ce n’est pas un hasard. C’est un moment où votre parole, votre vérité, votre histoire ont rencontré un point d’appui pour se transformer.
Comprendre la scansion, c’est accepter que le chemin thérapeutique se fait parfois par ruptures, par suspensions, par silences. Mais ces silences ne sont pas des vides : ils sont des respirations pleines, des temps de germination.
Et parfois, c’est justement ce qu’on n’a pas dit qui travaille le plus.