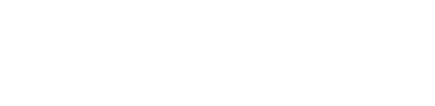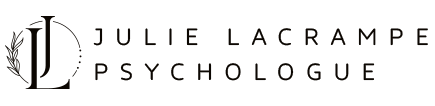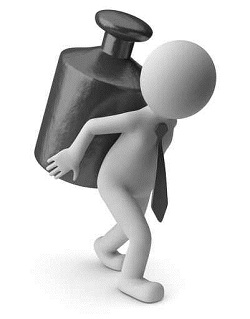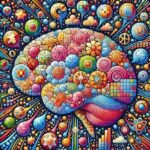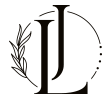Faire avec, faire autrement
« Ce qui importe, ce n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous. »
Jean-Paul Sartre – Saint Genet, comédien et martyr, début du chapitre « Je serai le voleur »
Dans le cadre de la psychothérapie, certaines phrases résonnent comme des points d’ancrage. Elles offrent une clarté brutale ou un éclairage nouveau sur la souffrance humaine, la responsabilité personnelle, et le devenir de soi. La citation de Jean-Paul Sartre : « Ce qui importe, ce n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous. », est de celles-là.
Cette phrase, souvent citée dans les milieux philosophiques et psychothérapeutiques, se prête à une exploration riche. Elle articule en quelques mots un paradoxe fondamental de la condition humaine : nous sommes à la fois produits et producteurs de notre histoire.
Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi
Entre passivité subie et responsabilité active
Dans sa première partie « Ce qui importe, ce n’est pas ce qu’on fait de nous » Sartre reconnaît l’évidence du déterminisme, du moins dans un premier temps de la vie. Nous ne choisissons pas notre naissance, notre famille, notre culture, nos premières blessures, ni même parfois les traumatismes qui jalonnent notre enfance ou notre adolescence.
En tant que psychologue, je rencontre quotidiennement des personnes qui portent en elles les stigmates de ce qu’on a fait d’elles : humiliations, abandons, violences, négligences, ou encore attentes parentales écrasantes.
Ce constat est essentiel : il légitime la souffrance, reconnaît l’injustice de certaines expériences et permet de sortir d’une culpabilisation souvent intériorisée. Il n’y a pas de faute à être blessé.
Mais Sartre ne s’arrête pas là.
La deuxième partie de la phrase « mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous.» introduit une bascule fondamentale : la possibilité, sinon l’exigence, d’un acte de liberté. Nous ne sommes pas entièrement définis par notre passé. Ce que nous devenons ne relève pas uniquement de ce que nous avons subi. Il y a un espace, peut-être ténu, mais réel, de transformation.
La responsabilité comme puissance de subjectivation
Dans une perspective thérapeutique, cette responsabilité n’est pas à comprendre comme une injonction culpabilisante à « s’en sortir » ou à « dépasser » ses traumas. Elle est, au contraire, une invitation à la subjectivation, c’est-à-dire à redevenir sujet de sa propre histoire.
Assumer la responsabilité de ce que je fais de ce qu’on a fait de moi, c’est reconnaître que, malgré les blessures, j’ai encore un pouvoir d’action. Cela peut signifier :
– Choisir d’aller en thérapie pour comprendre et apaiser son histoire ;
– Refuser de reproduire des schémas relationnels toxiques ;
– Nommer ce qui a été tu, mettre des mots sur l’indicible ;
– Faire le deuil de ce qui n’a pas été, et ouvrir des possibles.
Dans cette optique, la responsabilité n’est pas une charge mais une liberté retrouvée. Une liberté parfois douloureuse, car elle suppose de quitter certaines identifications, celle de la victime par exemple, mais une liberté pleine, celle qui permet de se réapproprier sa vie.
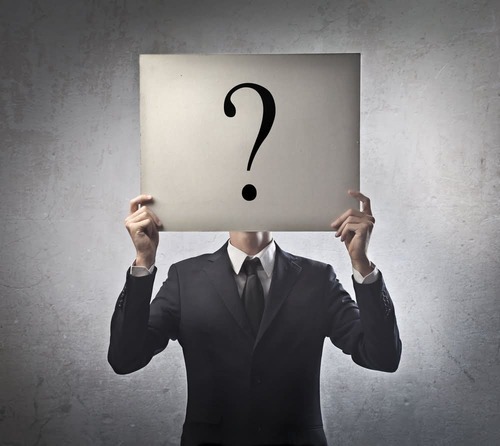
Le rôle de la psychothérapie : accueillir le passé, ouvrir le futur
Le travail psychothérapeutique s’inscrit précisément dans cet entre-deux : il accueille ce qui a été fait de la personne, sans minimisation, sans déni, tout en accompagnant le mouvement vers ce qu’elle peut en faire. Ce travail ne se fait ni dans la précipitation ni dans l’oubli. Il ne s’agit pas de « passer à autre chose », mais de traverser, d’intégrer, de transformer.
Beaucoup de patient(e)s expriment un sentiment de fatalité : « Je suis comme ça parce que j’ai vécu ça. » La psychothérapie vient interroger cette équation. Non pas pour l’invalider, mais pour en montrer les limites. On peut être marqué par son histoire, sans en être prisonnier. On peut reconnaître le passé sans lui donner le dernier mot.
Une éthique du devenir
Ce que nous dit Sartre, en somme, c’est que la liberté humaine ne réside pas dans le choix de nos circonstances, mais dans la manière dont nous y répondons. C’est une liberté exigeante, parfois vertigineuse. Mais elle ouvre un espace d’espoir lucide, celui où le sujet n’est plus condamné à répéter, mais invité à créer.
Dans un monde où les discours culpabilisants abondent (sur la santé mentale, l’échec, la parentalité, le travail) cette phrase nous ramène à une éthique fondamentale : celle du devenir. Elle ne nie pas la souffrance, elle ne la justifie pas. Elle affirme simplement qu’elle peut être travaillée, transformée, et même parfois source de sens.
Pour finir, la phrase de Sartre, en apparence simple, contient une vérité puissante que toute psychothérapie sérieuse explore : nous sommes à la fois le produit de notre histoire et les artisans de notre avenir. Ce que l’on a fait de nous ne nous condamne pas. Ce que nous faisons de cela, en revanche, est un terrain de liberté, de responsabilité, et de création de soi.