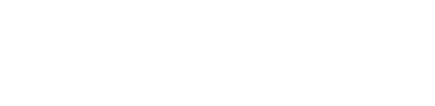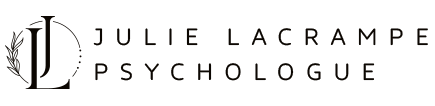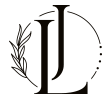Avoir le dernier mot : un besoin de contrôle ou une quête de reconnaissance ?
Qui n’a jamais ressenti ce besoin pressant de répliquer une dernière fois, de conclure une discussion par une phrase décisive, ou de ne pas laisser le silence sceller une parole qu’on estime injuste ?
« Avoir le dernier mot » : une expression familière, presque banale, mais qui révèle des enjeux psychiques profonds. Derrière ce réflexe apparemment anodin se cache parfois un mécanisme de défense, une peur de perdre la face, ou un besoin impérieux de reconnaissance.
Je vous propose d’explorer ce comportement sous un éclairage psychodynamique et relationnel.
« Avoir le dernier mot » ?
Dans le langage courant, avoir le dernier mot, c’est clore une conversation, un débat ou un conflit en s’imposant par sa parole finale. Cela peut prendre la forme d’une remarque tranchante, d’un argument supplémentaire, ou d’un mot ironique qui prétend marquer le point final. Loin d’être un simple jeu rhétorique, cette attitude traduit souvent un positionnement dans la relation à l’autre : qui décide ? qui domine ? qui a raison ?
Une affaire d’ego… mais pas seulement
La tentation d’avoir le dernier mot est fréquemment attribuée à l’ego. On l’associe à l’orgueil, au narcissisme ou à l’arrogance. Pourtant, ce besoin peut aussi masquer une insécurité profonde. Certaines personnes cherchent à conclure une discussion non pas parce qu’elles veulent gagner, mais par peur d’être laissées sans réponse, dans un vide relationnel perçu comme insupportable.
Avoir le dernier mot peut alors devenir un moyen de réassurance narcissique : « Si je conclus, je prouve que j’ai encore du poids dans la relation, que mon avis compte. »
Les enjeux inconscients : entre contrôle et angoisse d'abandon
En psychologie, ce comportement est parfois le symptôme de dynamiques plus complexes :
- ◊ Le besoin de contrôle : Chez certaines personnalités anxieuses, avoir le dernier mot est une manière de contenir l’imprévisibilité de l’échange. En contrôlant la fin, on maîtrise la narration.
- ◊ L’angoisse d’abandon : Pour d’autres, particulièrement chez des personnes qui ont des vécus d’insécurité affective, le silence ou la non-réponse de l’autre est vécu comme un rejet. Avoir le dernier mot, c’est maintenir le lien, même conflictuel.
- ◊ Le conflit archaïque : Chez des personnes marquées par des blessures précoces ou des traumas relationnels, le besoin de surenchère verbale peut renvoyer à une lutte archaïque pour la reconnaissance, l’attention, ou même la survie symbolique.
Un symptôme relationnel
Ce qui est intéressant, c’est que ce comportement prend tout son sens dans la dynamique relationnelle. Il ne s’agit pas simplement de la psychologie d’un individu isolé, mais d’un mode d’échange, d’un langage entre deux inconscients.
Dans un couple, par exemple, la récurrence des disputes où chacun cherche à « gagner » révèle souvent une impasse : on n’écoute plus pour comprendre, mais pour répliquer. Ce besoin d’avoir le dernier mot empêche toute véritable rencontre.
Et dans le cadre thérapeutique ?
En séance, j’essaie souvent de conclure en apportant une réflexion en vue de la prochaine consultation, soit en m’arrêtant sur ce que le patient vient de dire, soit en posant une question ouverte. Cependant, pour certains patients, il est difficile de ne pas continuer à parler. Quelle est la fonction de ce « dernier mot » chez le patient ? Est-ce une tentative de fuite ? Un appel à la contenance ? Une manière de tester la solidité du cadre ?
La capacité du thérapeute à tolérer de ne pas avoir le dernier mot devient alors un levier clinique puissant. En acceptant de ne pas « conclure », il ouvre un espace de travail psychique, un vide fécond où peut advenir autre chose que la répétition.
Vers une parole plus libre
Se libérer du besoin d’avoir le dernier mot ne signifie pas se taire, ni se soumettre. Il s’agit plutôt de se désengager de la logique de combat, pour entrer dans une parole vivante, fluide, qui n’a pas besoin d’être tranchante pour être entendue.
Cela suppose une certaine sécurité intérieure, une capacité à laisser l’autre penser différemment sans que cela ne nous efface, à supporter l’inachèvement, voire l’incompréhension. En d’autres termes, il s’agit d’accepter que la relation prime sur la raison.
« Avoir le dernier mot » peut sembler anodin, voire amusant dans certaines situations. Mais ce réflexe révèle souvent un enjeu beaucoup plus profond : le besoin d’être entendu, reconnu, validé dans son existence. Plutôt que de chercher à avoir le dernier mot, pourquoi ne pas tenter d’écouter vraiment, y compris ce que l’on ne comprend pas, ce qui résiste, ce qui nous dérange ?
Peut-être est-ce là, dans cette ouverture, que se joue le véritable « dernier mot » : celui qui n’appartient à personne, mais fait place à l’altérité.